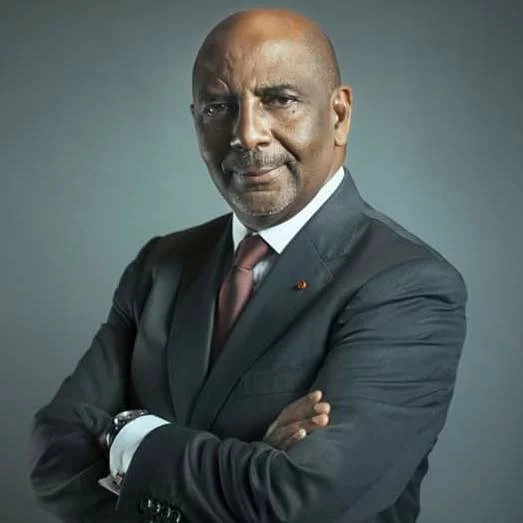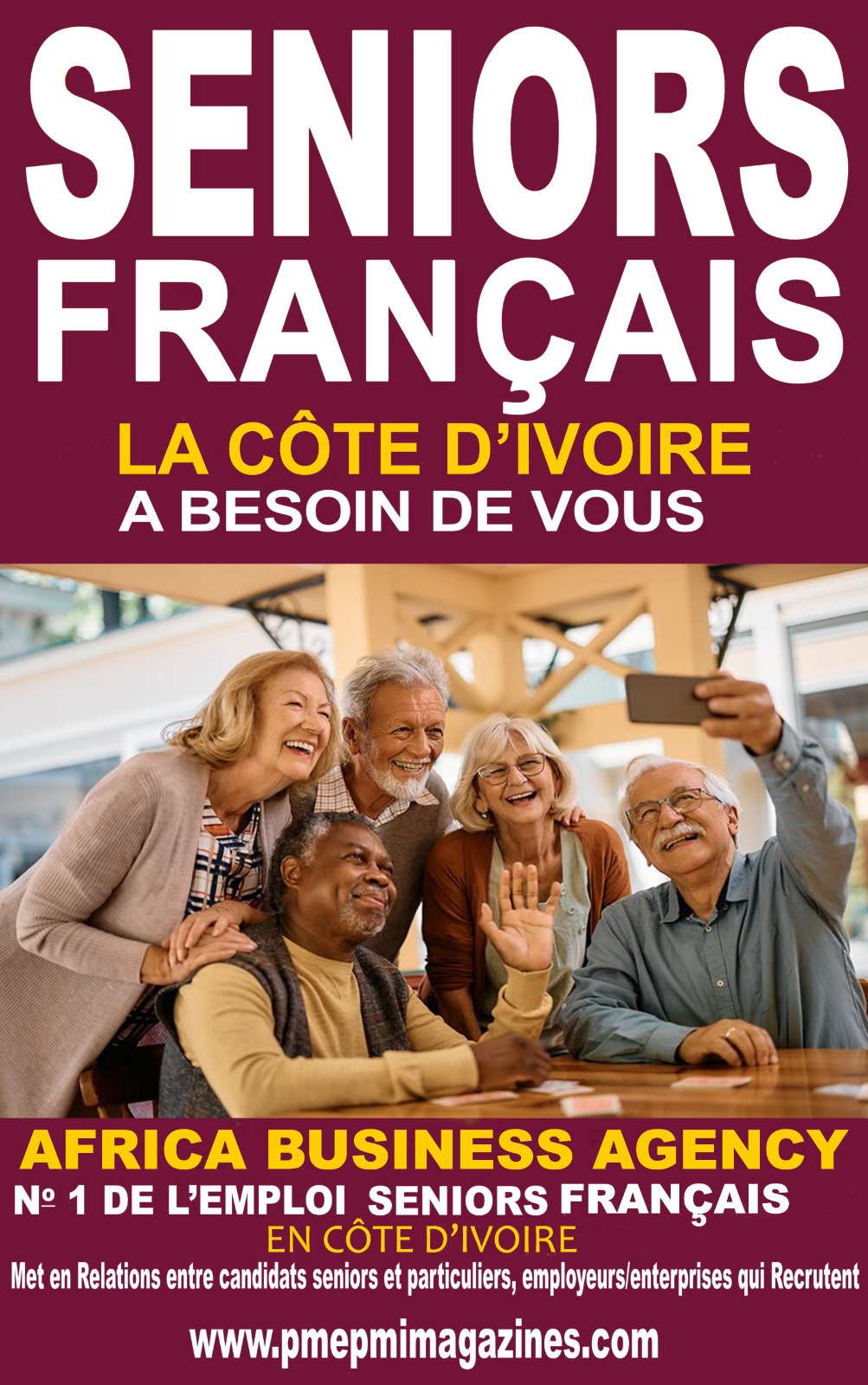Si la haute administration chinoise comporte de nombreux économistes qui ont été formés en Occident, cela signifie-t-il qu’elle n’aura pas le courage de dire non aux politiques monétaires des banques centrales occidentales ? Pourra-t-elle capitaliser sur sa politique qui a fait la promotion de l’or durant ces dernières années ? Si la Chine devait prendre une telle voie, elle pourrait ressortir plus forte de la prochaine crise.
Stratégie financière et monétaire post-Mao
Suite à la disparition de Mao Tsé Toung en 1976, le leadership chinois s’est retrouvé face à une question existentielle. Après le départ de Mao, l’élément qui était parvenu à rassembler plus de 40 groupes ethniques n’était plus. Il s’agissait de la fin d’une ère, qui exigeait de définir une nouvelle approche. Un échec aurait fait courir à la Chine le risque de la dislocation à travers la désobéissance civile, voire même une guerre civile multiethnique.
Des gens sages, qui avaient observé les succès remarquables de Hong Kong et de Singapour sous l’impulsion de la diaspora chinoise, ont pris le dessus. Il était clair que pour assurer sa survie, le parti communiste chinois devait adopter le capitalisme tout en conservant le contrôle politique du pays. Le successeur désigné de Mao, Hua Gofeng, n’a pas tenu un an vu qu’il était arrivé là en raison de sa loyauté indéfectible. C’est son successeur, Deng Xiaoping, qui a réinventé la Chine. À la fin des années 70, Deng a redéfini l’ennemi principal de la Chine, l’Union soviétique, en raison de son implication au Vietnam. À ce moment clé de la Chine, celle-ci a pu établir une relation stratégique avec les États-Unis grâce à cet ennemi commun.
Les graines de cette relation avaient déjà été plantées en 1972 par la visite de Nixon en Chine. Les Américains étaient prêts à accompagner l’entrée de la Chine dans leur monde. Au cours des années 80, la Chine s’est ouverte aux investissements des sociétés américaines et autres. La construction d’usines à la main-d’œuvre bon marché a démarré.
En 1983, il est devenu clair que la Banque centrale chinoise avait un problème monétaire grandissant vu qu’elle accumulait toutes les devises étrangères disponibles afin de pouvoir émettre du yuan utilisé sur son marché intérieur. La banque centrale a donc mis en place une politique du yuan faible afin de stimuler le développement économique du pays. Elle était également la seule à pouvoir acheter des métaux précieux pour contrebalancer cette politique, les Chinois n’avaient pas le droit d’acheter de l’or et de l’argent métal.
Années 80 : les achats d’or démarrent
À l’époque, les achats d’or chinois étaient dictés par le simple impératif de diversification des réserves du pays. Les leaders chinois avaient compris la différence entre l’or et l’argent papier, comme les Arabes l’avaient fait dans les années 70 ou encore les Allemands, dans les années 50. Il était prudent d’avoir de l’or physique. De plus, la théorie économique marxiste enseignée dans les universités d’État avait imprimé dans la tête des étudiants que le capitalisme occidental était certain de mourir, et par corollaire que les devises papier perdraient leur valeur.
L’accumulation secrète d’or par la Chine durant les années 80 était aussi une assurance contre une future instabilité économique. C’est pourquoi le métal fut dispersé via des institutions clés telles que l’armée, le parti communiste et les jeunesses communistes. Seule une infime fraction de l’or fut déclarée en tant que réserves.
Durant les années 90, les entrées de capitaux ont commencé à être complémentées par les revenus des exportations. C’est alors qu’une nouvelle classe de Chinois riches a émergé. La Banque centrale chinoise disposait toujours d’une montagne embarrassante de dollars. Heureusement, l’or était boudé par les Occidentaux, et donc disponible à des prix toujours plus intéressants. La Banque centrale chinoise fut ainsi en mesure d’acheter de l’or en grande quantité et en catimini pour le compte d’institutions du pays.
Avec business&bourse