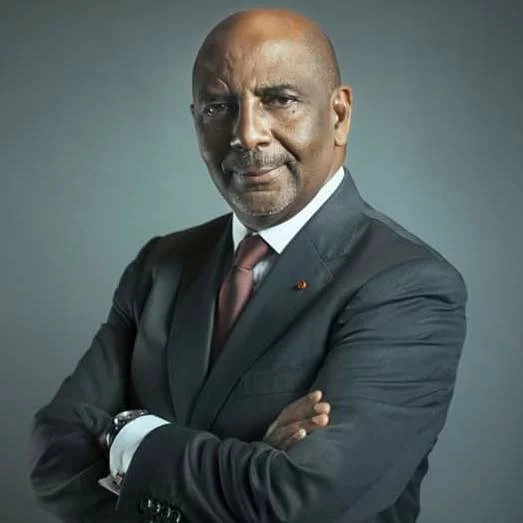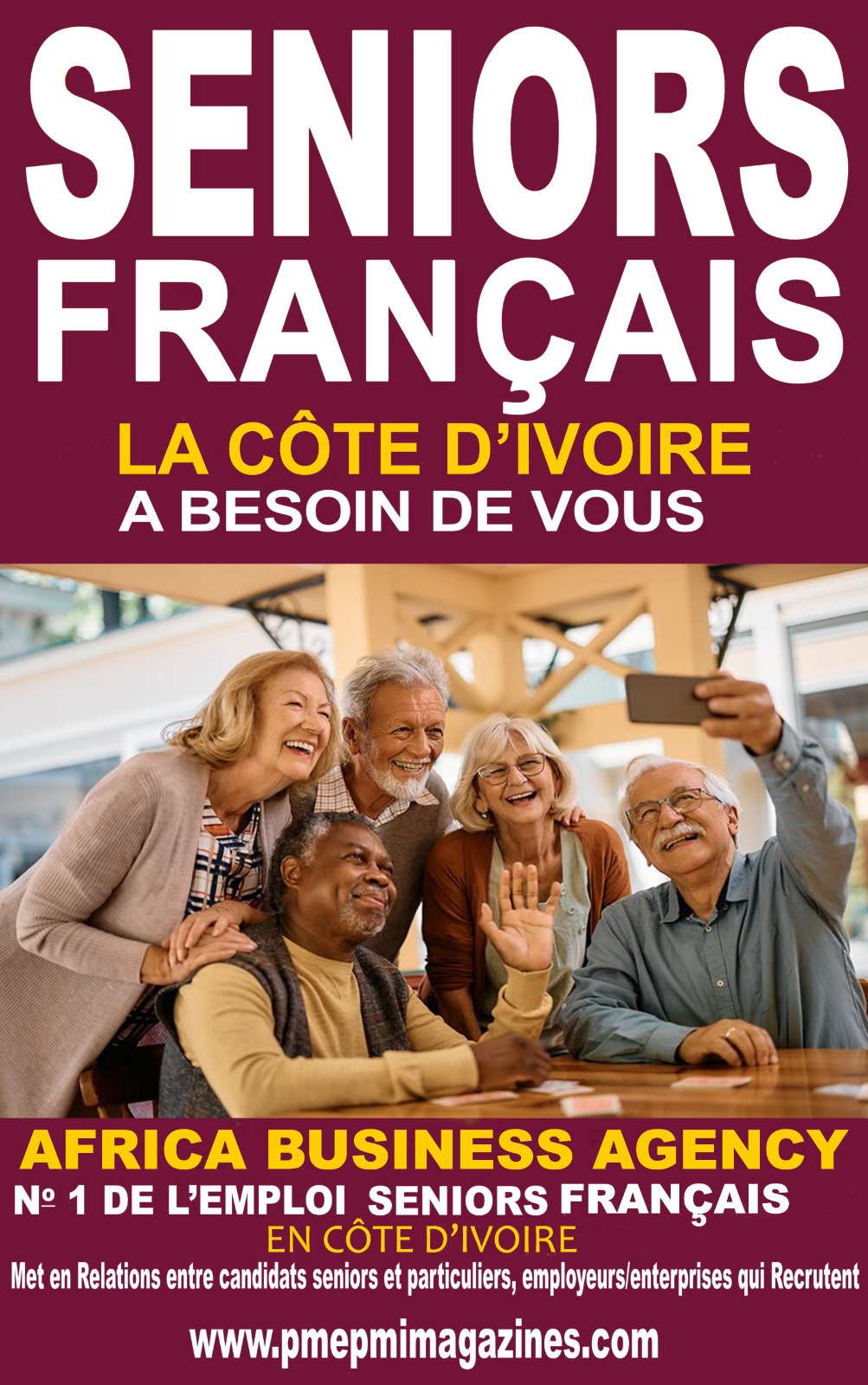Quelle équipe nationale de football a été sacrée championne olympique à Londres il y a quatre ans ? Quel pays détient le record de médailles d’or olympiques en matière de football ? Deux colles qui peuvent faire sécher les plus fervents passionnés du ballon rond, alors qu’ils n’auraient pas la moindre hésitation pour évoquer le tableau d’honneur du dernier Mondial ou du récent Euro. Le faible rayonnement du football aux JO est l’un des plus gros paradoxes du sport. Les victoires olympiques ont fait entrer dans la légende des sprinteurs, des nageurs, des judokas, mais pas le moindre footballeur.
L’olympisme n’aime pas le football… qui le lui rend bien. Cette animosité remonte à l’entre-deux-guerres et met en exergue l’opposition entre le sport professionnel et le sport amateur. Les JO de 1924 à Paris avaient accordé une belle place au ballon rond avec un tournoi olympique de foot étalé sur 15 jours (du 25 mai au 9 juin). La compétition avait connu un vrai succès, avec des rentrées évaluées à 1 798 751 francs, et qui représentaient 33 % des recettes totales de ces JO estimées à 5 423 184 francs (1). Le tournoi, remporté par l’Uruguay, avait été relevé avec des équipes bien préparées et prouvait que le professionnalisme constituait la clé pour accéder au très haut niveau.
Cynisme contre hypocrisie
Mais cette réussite économique et sportive laissa de marbre le CIO qui, lors du congrès de Prague en mai-juin 1925, édicta la règle suivante : « Ne pourrait être qualifié pour participer aux Jeux : celui qui était ou aurait en connaissance de cause professionnel dans son sport ou un autre sport et celui qui aurait reçu des remboursements pour compensation de salaire perdu. » C’est la consécration du sport amateur cher à Pierre de Coubertin. Noble idéal. Mais qui suppose que le sport est une affaire de riches qui n’ont pas besoin de gagner leur vie et ne doit pas être un ascenseur social. Pour le baron, il était inconcevable d’être rémunéré pour exercer une activité physique. Le sport amateur, c’est du loisir et non pas de la compétition. L’essentiel, c’est de participer…
Sauf que cette restriction n’a pas résisté longtemps à l’impact économique du ballon rond. En effet, dès l’origine, le CIO qui prône une vision désintéressée du sport a pour moteur l’argent : les premières éditions des JO (Paris 1900, Saint-Louis 1904, Londres 1908) s’organisèrent d’ailleurs en marge des foires commerciales que furent les expositions universelles. En août 1927, la Fifa fait plier l’institution olympique : aux Jeux d’Amsterdam de 1928, les « amateurs » toucheront désormais au plus « 75 % de leur salaire pour les célibataires et 90 % pour les hommes mariés et célibataires qui sont soutiens de famille ». Le podium foot de ces JO était composé de l’Uruguay, de l’Argentine et de l’Italie, trois nations à l’avant-garde du professionnalisme. Et le football représenta encore un tiers des rentrées d’argent totales de ces Jeux. Mais la face olympique était sauvée : les footballeurs conservaient ce statut amateur le temps du tournoi.
L’Europe de l’Est confisque le foot aux JO
La Fifa, rancunière, ne tarda pas à s’émanciper définitivement du CIO en créant la Coupe du monde qui inclurait, elle, les joueurs professionnels. La première édition se déroula en 1930, soit deux ans après la réussite économique des JO d’Amsterdam. L’année choisie n’est pas anodine. Comme pour l’olympisme, le Mondial aura lieu tous les quatre ans. Mais en débutant en 1930, il ne peut se disputer la même année que les JO. Ainsi, les deux plus gros événements sportifs de la planète ne se concurrenceront jamais directement.
La Coupe du monde se développe après la Seconde Guerre mondiale, ce qui conduit beaucoup de nations de l’Europe de l’Ouest, où le professionnalisme est désormais la règle, à délaisser les JO. À partir des années 1950, et jusqu’en 1980, les médailles d’or de football aux JO seront confisquées par les équipes de l’Europe de l’Est. En effet, le bloc soviétique interdit aux sportifs d’avoir le statut professionnel. Ce qui n’empêche pas les footballeurs hongrois, tchèques ou russes d’avoir un niveau aussi bon, voire meilleur (pour la Hongrie de Puskas des années 50 et l’URSS de Yachine des années 60) que les joueurs pros qui évoluent de l’autre côté du Rideau de fer.
Réforme en 1984
À force de voir les équipes de l’Europe de l’Est confisquer les médailles d’or aux JO, le football olympique se réforme pour l’édition de 1984 et s’ouvre au monde professionnel. Mais c’est cette fois, la Fifa se montre restrictive et impose que les joueurs participants d’Europe et d’Amérique du Sud ne doivent pas avoir disputé plus de cinq matches en sélection. L’Asie, l’Océanie, l’Afrique et l’Amérique du Nord ne sont pas concernées par cette règle. Une aubaine pour des pays comme le Nigéria (1996) ou le Cameroun (2000) qui en profitent pour remporter un tournoi supra-continental et ne plus se limiter à la Coupe d’Afrique des nations.

Un changement qui s’avère insuffisant puisque l’URSS gagne une nouvelle fois les JO en 1988. Conséquence, le règlement est de nouveau modifié pour les Jeux de Barcelone de 1992 : tous les joueurs pros de moins de 23 ans ont le droit d’y participer.
Mais la rivalité entre CIO et Fifa ne disparaît pas. En 1999, la Fifa impose que les matches de foot disputés dans le cadre des JO depuis 1960 ne soient pas comptés comme des rencontres de sélection nationale. La Fifa n’inscrit pas non plus le tournoi olympique dans son calendrier. Tel Ponce Pilate, elle s’en lave les mains : elle n’arbitre pas les litiges entre les fédérations nationales qui veulent leurs meilleurs représentants pour les JO et les clubs qui ne veulent pas lâcher leurs joueurs alors que le début de la saison est imminent. Le défenseur brésilien Marquinhos qui a fait pression cet été sur le PSG pour disputer les JO est l’un des récents exemples…
avec lepoint