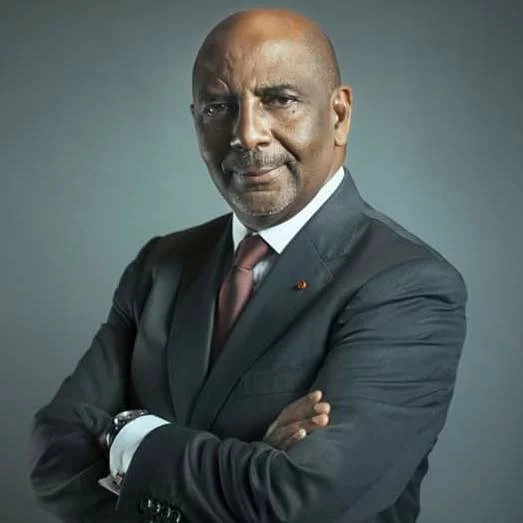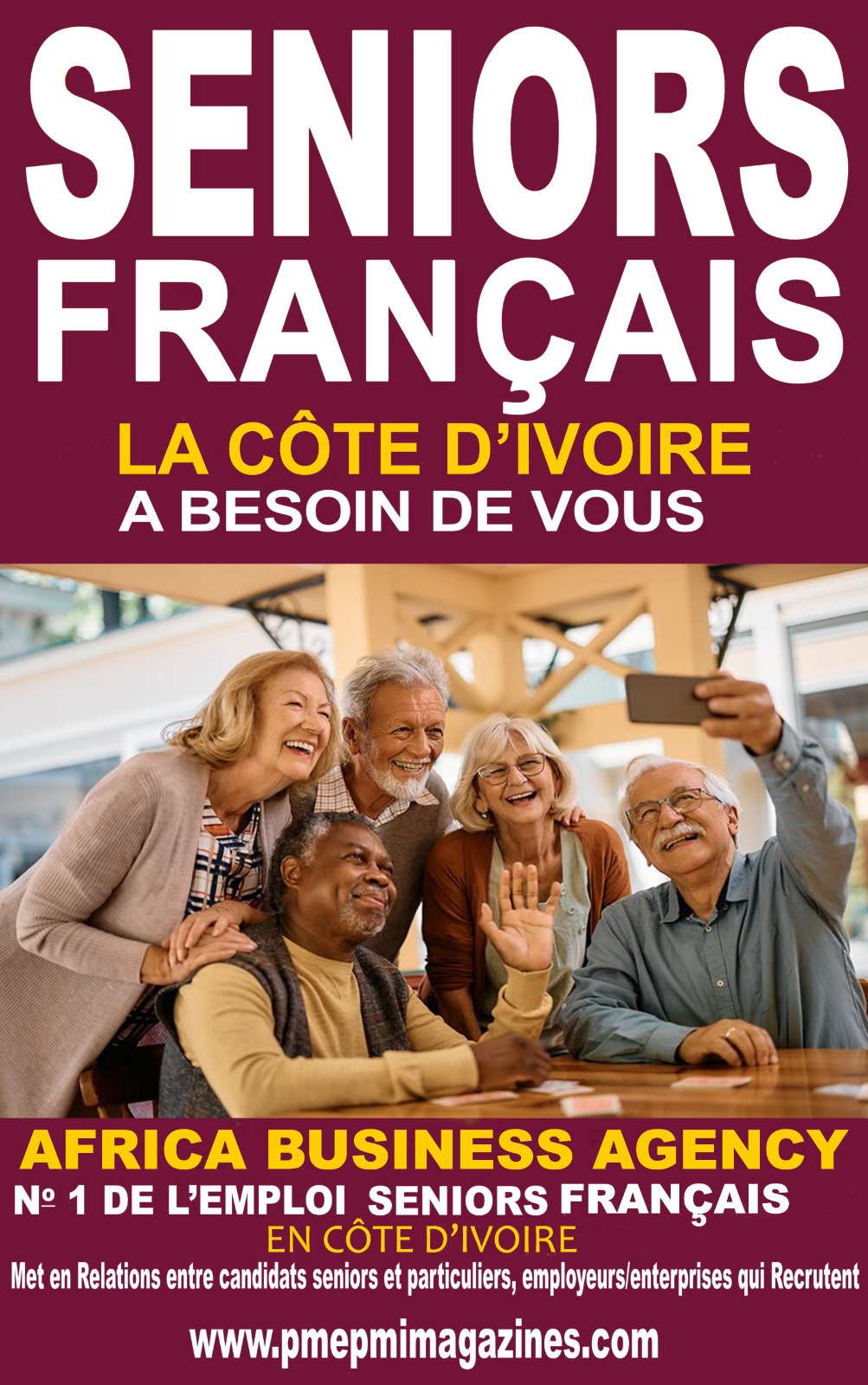Dédié aux intellectuels et aux scientifiques, ce nouvel espace doit montrer toute la pluralité, la diversité et la richesse de l’espace francophone dans un contexte où les débats d’idées s’entrechoquent de plus en plus.
Pour d’emblée clarifier les choses, Alain Prochiantz, administrateur du Collège de France, a déclaré ce mercredi 4 juillet que « ce n’est pas une chaire sur la Francophonie mais une chaire où des gens qui pensent et écrivent en français trouvent l’hospitalité chez nous ». La chaire des Mondes francophones se veut être une véritable tribune ouverte aux intellectuels parlant français de par le monde. Et preuve de cette ouverture tant attendue, c’est l’écrivaine haïtienne Yanick Lahens qui en sera la titulaire dès 2019 pour trois ans. Au cœur de sa mission et en partenariat avec l’agence universitaire de la Francophonie, elle devra o uvrir la langue française aux savoirs d’ailleurs et aux études post-coloniales.
Les mondes francophones enfin reconnus ?
En fait, Alain Prochiantz, qui est à la tête de l’institution parisienne vouée à la recherche et son enseignement dans tous les domaines des sciences et des arts depuis 2015, sait qu’il a fort à faire pour convaincre une frange des intellectuels francophones, car les débats font rage autour de la francophonie. « Il peut y avoir des contradictions sur l’idée dont on [la] conçoit », a-t-il admis alors que des voix se sont récemment élevées pour exiger une francophonie plus africaine.
Lors de son discours de Ouagadougou fin novembre 2017, le président français Emmanuel Macron avait, avec des accents pleins d’optimisme, fait le constat que « le français sera la première langue de l’Afrique et peut-être du monde ». De quoi intégrer la nouvelle donne qui marque l’espace linguistique francophone, à savoir la plus forte croissance de tous les espaces linguistiques avec ses + 143 % prévus entre 2015 et 2065, contre les + 62 % pour l’anglais, selon l’ONU. En effet, d’ici à 2065, un milliard de personnes devraient parler français, soit cinq fois plus qu’en 1960, au deuxième rang des langues internationales derrière l’anglais. Le chef de l’État avait à ce titre lancé, le 20 mars, une francophonie qu’il a voulue « décentrée » de la France et faisant la part belle à l’Afrique, berceau de l’actuelle expansion de la langue française.
« Le président avait appelé à la création de chaires francophones dans les instituts d’enseignement. Nous répondons à cette incitation », a reconnu l’écrivain français Antoine Compagnon, professeur du Collège qui a porté la création de la chaire. D’autres chaires pourraient se créer sous peu, notamment à l’Académie royale de Belgique et à l’université d’Aix-Marseille (France), a souligné Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l’Agence universitaire francophone (AUF), partenaire du Collège dans la création de la chaire.
On peut toutefois souligner que le Collège de France a déjà fait un grand pas dans la direction de l’ouverture lorsqu’Alain Mabanckou, l’écrivain franco-congolais, occupa la chaire de création artistique en 2016.
Yanick Lahens veut « décoloniser les savoirs »
L’écrivaine haïtienne Yanick Lahens, 65 ans, prix Femina en 2014 pour Bain de lune, a été élue titulaire et prononcera, le 21 mars 2019 en pleine Semaine de la francophonie, sa « leçon inaugurale » qui, traditionnellement, ouvre un cours au Collège. « La création de cette chaire par le Collège de France en partenariat avec l’AUF est d’une très grande importance parce qu’elle est le signe que, dans ce haut lieu symbolique du savoir qu’est le Collège de France, se pose la question de la nécessité de s’ouvrir à d’autres espaces, d’autres savoirs. Cette démarche est essentielle pour comprendre les enjeux du monde d’aujourd’hui. Un monde dans lequel nous sommes de plus en plus exposés les uns aux autres, où les imaginaires se sont complexifiés et où nous sommes appelés à ne plus être cloisonnés dans des frontières, une identité ou une langue. Quel meilleur choix pour éclairer ces mutations que de partir d’Haïti “où le colonialisme s’est noué et s’est dénoué pour la première fois”. De sa littérature écrite en grande partie en langue française. Haïti aujourd’hui au carrefour de plusieurs souffles, de plusieurs langues pose la question centrale de “l’habiter” dans un tel monde, a souligné Yanick Lahens, point de vue qu’elle développe dans la conversation que nous avions enregistrée avec elle au Salon du livre de Paris en mars dernier, à l’occasion de la sortie de son dernier roman Douces déroutes, chez Sabine Wespieser.
Yanick Lahens a “une expérience solide de l’enseignement, notamment à l’Université d’État de Haïti, et peut parler au public très abondant qu’elle aura ici”, a souligné Antoine Compagnon. Les cours du Collège, très suivis sur place, sont également disponibles sur le site de l’institution, pionnier de l’enseignement à distance avec 4 millions de téléchargements par an.
Avec le point afrique