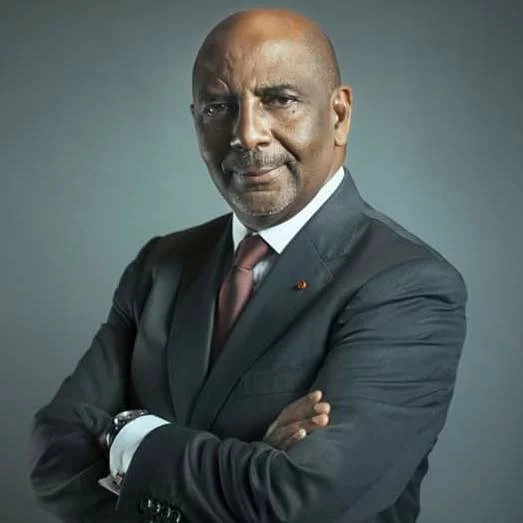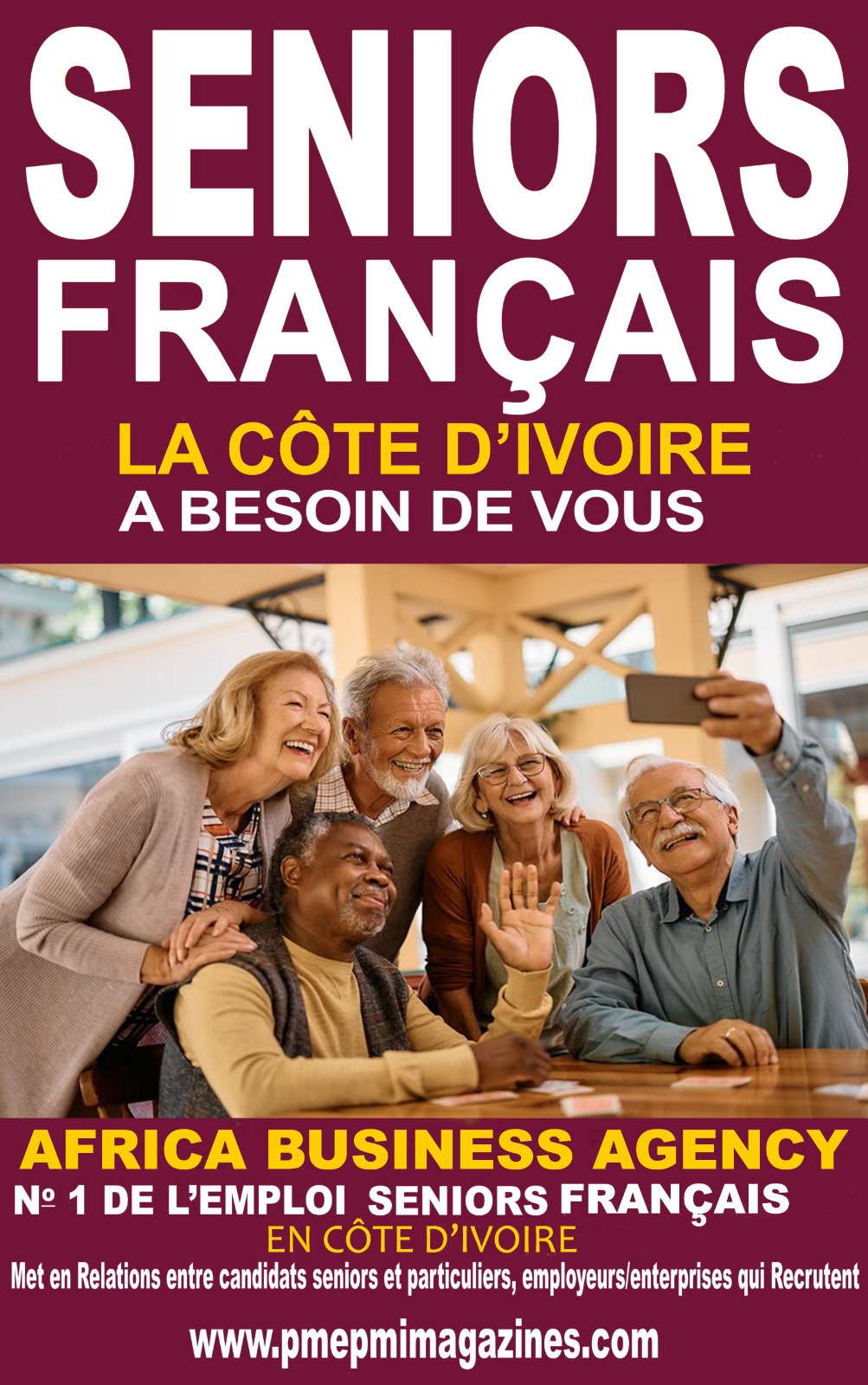PAROLES D’AVOCATS 2/10. L’Afro-optimisme n’est plus béat, il est fondé sur des fondamentaux qui permettent d’envisager des réponses aux principaux défis du continent en faisant fi du carcan chronologique.
Pour la sixième fois en 10 ans, le 16 juin dernier, la Fondation Mo Ibrahim a considéré qu’aucun des leaders africains n’était digne du prix du « leadership » au titre de l’année 2015. Aussitôt, la rengaine de la mauvaise gouvernance africaine a repris, comme si Boko Haram, Ebola et la chute du prix du baril ne suffisaient pas. L’Afro-optimisme serait donc bien mort après n’avoir émergé que cinq petites années.
Le potentiel considérable de l’Afrique est pourtant bien là, pour qui veut le voir et n’a pas peur des paradoxes et des idées neuves : « La démocratie et les droits de l’Homme ne sont pas nécessairement les conditions préalables à la croissance économique ». Il est notable que la Fondation Bill et Melinda Gates ait rejoint sur ce constat l’ancien Premier Ministre éthiopien Mélès Zenawi, lorsqu’elle a établi son premier bureau africain à Addis Abeba. Avec une croissance de 10,5% en 2015, faisant fi de la crise mondiale et de la chute des cours des matières premières, l’Ethiopie s’affirme comme la puissance économique montante de l’Afrique de l’Est. Le Rwanda a également trouvé, sous la férule du Président Kagamé, un modèle de développement discutable mais dont les résultats en matière d’éducation, de santé, d’urbanisme et d’infrastructures sont visibles.
Pourquoi faut-il croire en l’Afrique ? D’abord à cause de sa multiplicité, de la variété de ses communautés humaines bien plus nombreuses que ses Etats-nations, de la richesse de son histoire et de sa culture. Mais surtout parce que ses nouvelles générations ont envie. Envie de travailler : les trois dernières générations veulent se construire un avenir meilleur que celui que leur ont légué leurs anciens. Elles ont des projets simples comme habiter sa propre maison, nourrir sa famille et vivre plus confortablement que leurs aînés. Des idées que ceux qui passent leurs nuits debout de ce côté-ci de la Méditerranée qualifieront de bourgeoises, mais qui au sud du Sahara changent la vie des familles et diminuent la mortalité infantile. Envie de consommer avec, selon les dernières études, un marché de 1,1 milliard de consommateurs d’ici cinq ans, soit plus que l’Europe et l’Amérique du Nord réunis, mais surtout un marché de consommateurs optimistes, deux fois plus que celui des pays matures.
L’Afro-optimisme n’est plus béat, il est fondé sur des fondamentaux qui permettent d’envisager des réponses aux principaux défis du continent en faisant fi du carcan chronologique. Ainsi les sauts technologiques, culturels et humains ont déjà démontré qu’une population n’ayant jamais eu accès au téléphone fixe pouvait optimiser l’utilisation de la téléphonie mobile pour en faire un outil de communication, de commerce et même de transaction financière pour compenser le faible taux de bancarisation des populations africaines. Ce succès a vocation à être dupliqué dans de nouvelles formes de production et de distribution d’électricité, d’eau et de moyens de transport.
Dans une société rompue à l’économie informelle, l’ubérisation a vocation à créer des dynamiques plus rapidement que dans les sociétés développées, parfois empêtrées dans leurs protections corporatistes. L’accès internet, encore balbutiant, devrait connaître dans les cinq années un essor considérable par le déploiement de solutions très haut débit, en fibre raccordant directement les usagers aux stations d’atterrissement des câbles sous-marins internationaux, transformant les principales villes côtières en centres numériques connectés, plus rapidement que la plupart des villes européennes. Alors ouvrons grands nos yeux car nous serons surpris.
Reste le défi majeur, celui du fossé social, économique, numérique, culturel et même religieux qui s’accroît entre les zones rurales reculées et les zones urbaines développées dont le mode de vie et de consommation s’uniformise avec celui des autres capitales dans le monde. Des mécanismes de service universel permettent de réduire cette fracture. Leur mise en œuvre dans les villages contribuera à réduire, à leurs sources, les risques sécuritaires et migratoires.
Rémy Fekete, avocat associé du cabinet Jones Day en charge des pratiques Télécoms, Médias & Technologies (TMT) et Afrique.