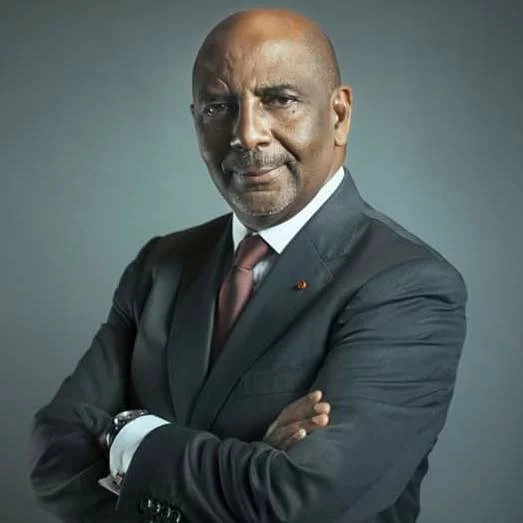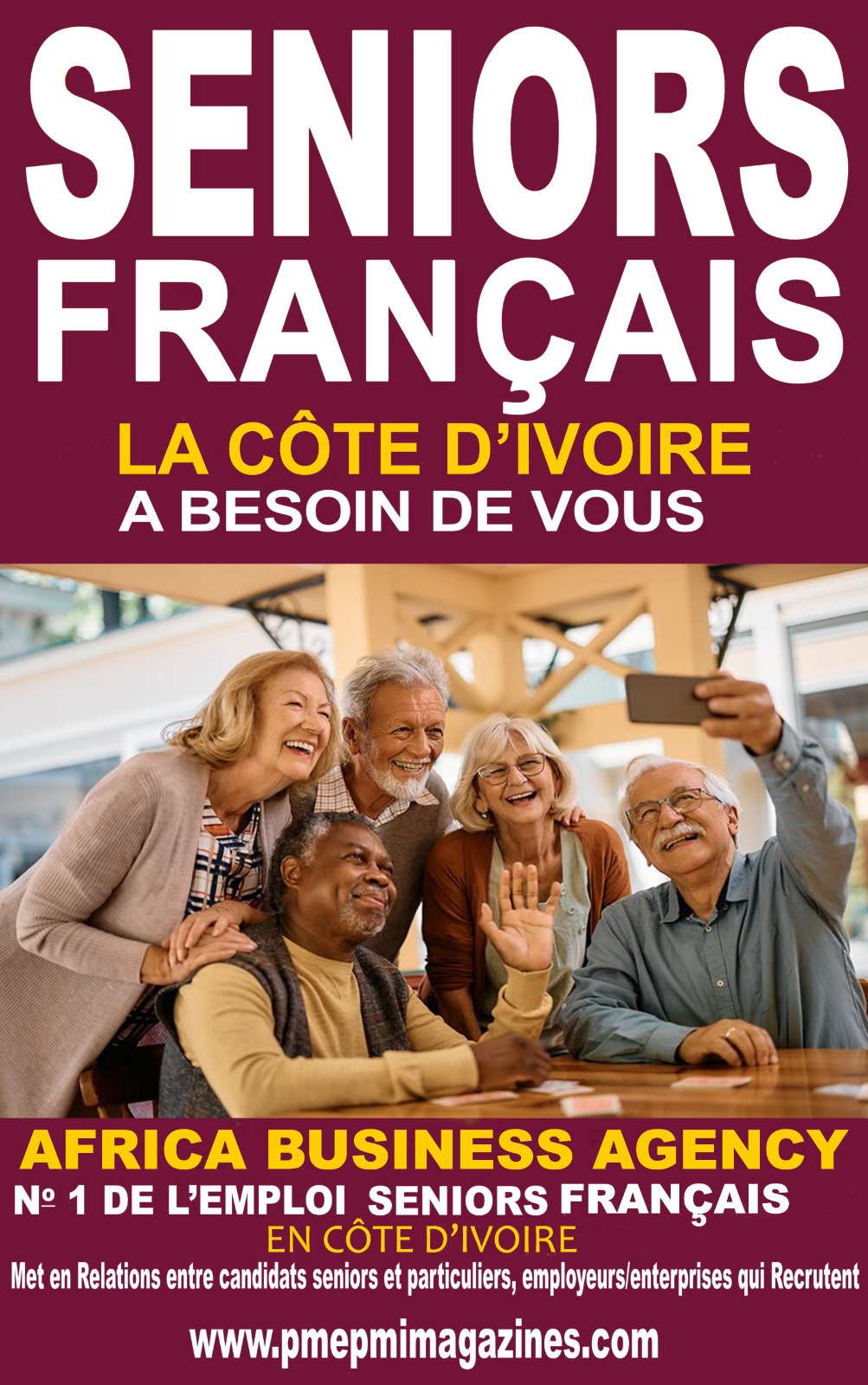Une nouvelle combinaison thérapeutique pourrait être efficace contre certains cancers avancés de la prostate.
CANCER. Face à certains cancers de la prostate très agressifs, un nouvel espoir se profile du côté des traitements. L’avancée vient du Québec avecdes travaux de l’université de Montréal qui propose une nouvelle combinaison thérapeutique. Avec plus de 70.000 nouveaux cas par an, le cancer de la prostate est la deuxième cause de mortalité par cancer chez l’homme. Lorsqu’il est limité à la glande, le traitement est local et repose sur la curiethérapie, la radiothérapie ou la chirurgie selon les cas, voire une simple surveillance par IRM. Par contre, face à des formes plus agressives et évoluées, des traitements dits d’hormonothérapie, avec ou sans radiothérapie, sont proposés. Aujourd’hui, cette hormonothérapie repose sur des médicaments dits anti-testostérone qui s’opposent à l’action de l’hormone masculine sur la croissance des cellules cancéreuses.
Sécurité et efficacité
Les chercheurs canadiens proposent ici d’associer un anti-testostérone, l’acétate d’abiratérone (Zytiga) à un autre médicament, non encore approuvé sur le marché, le JNJ-56021927. « Nous espérons avoir trouvé un traitement bien toléré et efficace pour freiner la progression d’un type particulier de cancer de la prostate avancé », explique le Dr Fred Saad, auteur principal de l’étude. Son équipe a analysé les premiers résultats d’une étude internationale déjà menée dans 196 hôpitaux à travers le monde et déjà en cours auprès d’une quarantaine de patients. Face aux résultats de ces premiers essais dits de phase 1 démontrant sécurité et efficacité, la Food and Drug administration (FDA) des États-Unis comme Santé Canada viennent de donner leur feu vert rapide à l’élargissement de cette association à près de 1000 patients dans le monde. Il s’agira de comparer l’efficacité de l’acétate d’abiratérone (1.000 mg) et un placebo à un traitement combinant l’acétate d’abiratérone (1.000 mg) et le JNJ-56021927 (240 mg). Selon le Dr Saad, les conclusions de cette étude internationale ne seront pas connues avant environ trois ans.
avec scienceetavenir