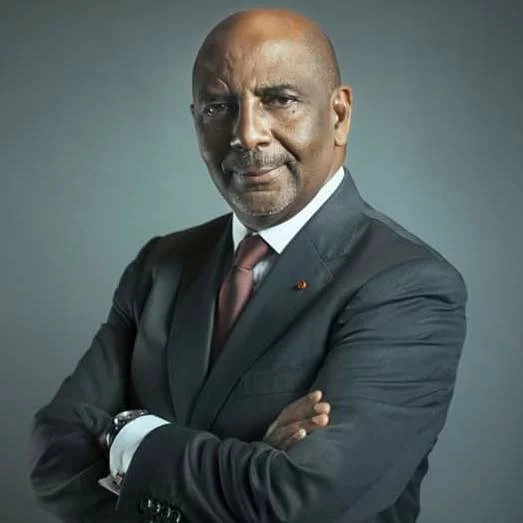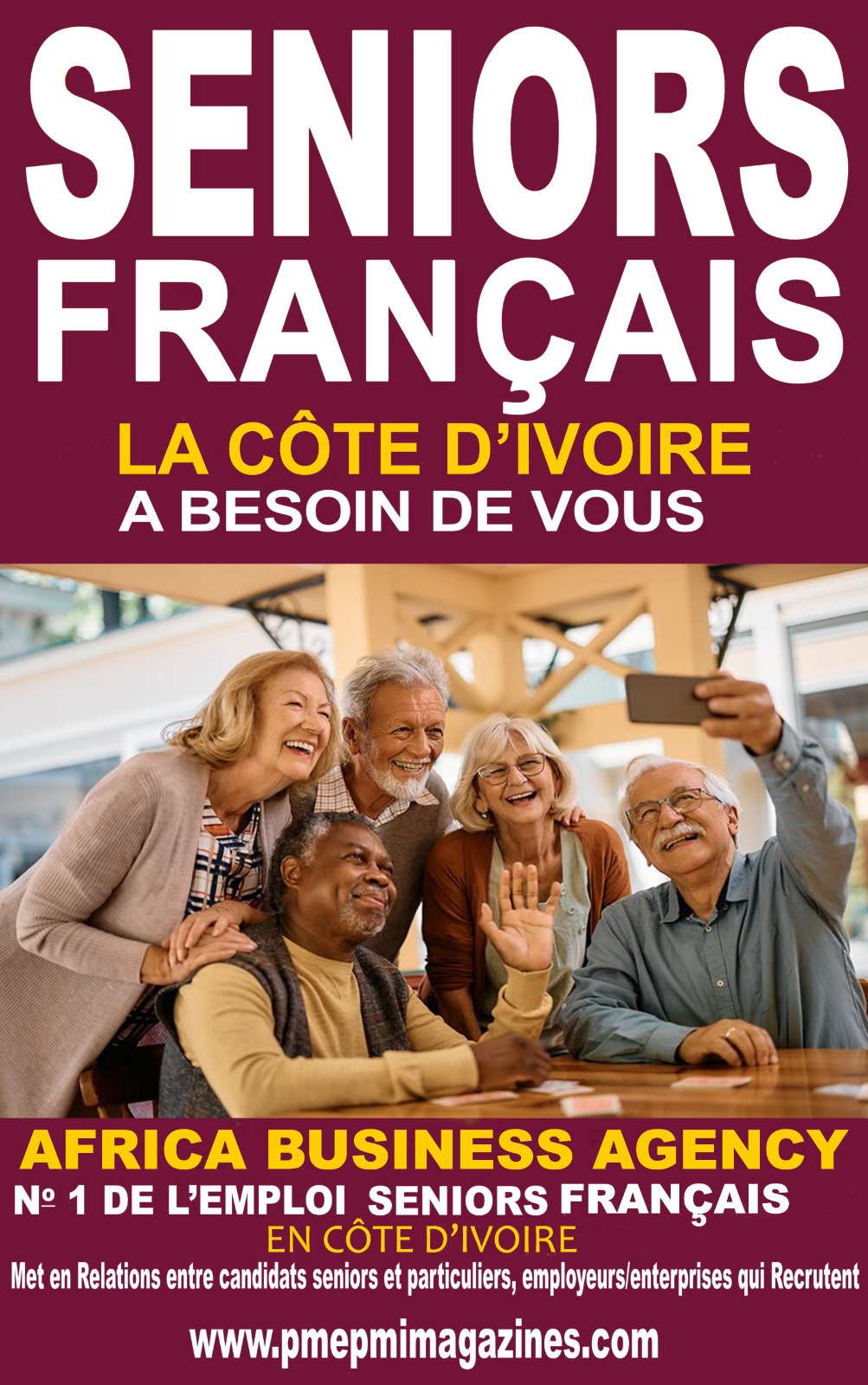Cinq chercheurs de l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et deux de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) du Canada, travaillent sur un projet tendant à produire des bioplastiques à partir de jus de pomme de cajou en Côte d’Ivoire, rapporte L’intelligent d’Abidjan.
Ce projet, qui consiste à générer des bioplastiques à partir de la fermentation du sucre contenu dans les pommes de cajou, et dont la phase exécutoire démarrera en janvier 2016, durera 18 mois; son coût serait de € 118 000. Une partie des travaux sera réalisée au Canada et une autre en Côte d’Ivoire.
La production ivoirienne de pomme de cajou est estimée à environ 5 millions de tonnes (Mt), une estimation difficile à établir car la pomme est habituellement abandonnée sur les lieux de récolte.
« Selon les autorités ivoiriennes, la production moyenne annuelle de sachets plastiques dérivés du pétrole est de l’ordre de 20 000 t et toute cette production est destinée à la consommation domestique. Or, plus de 50% des déchets générés sont évacués directement dans les rues, tandis que moins de 20% de ceux-ci sont recyclés et triés. La conséquence immédiate de cette situation est la pollution accrue de l’environnement et plus particulièrement de l’eau et des écosystèmes aquatiques« , soulignent les chercheurs.
» Face à cette situation, le gouvernement ivoirien à travers le décret 2013-803 du 22 novembre 2013, a interdit la production, l’importation, la commercialisation, la détention et l’utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Ainsi, il y a un grand intérêt à produire des bioplastiques, dont les avantages sont énormes », poursuivent-ils, rapporte notre confrère.
Quant à l’aspect technique, les chercheurs livrent leurs calculs. « Une quantité de 3 500 000 t de jus (contenant 10-12% p/v de sucre –glucose et fructose) peut être annuellement produite et une quantité de 420 000 t de sucre de pommes de cajou peut fournir approximativement 335 000 t de bioplastiques par année », expliquent-ils.
Selon Malamine Sanogo, directeur général du Conseil du coton et de l’anacarde, seulement 42 000 t d’anacarde sont transformées localement.
avec commodafrica