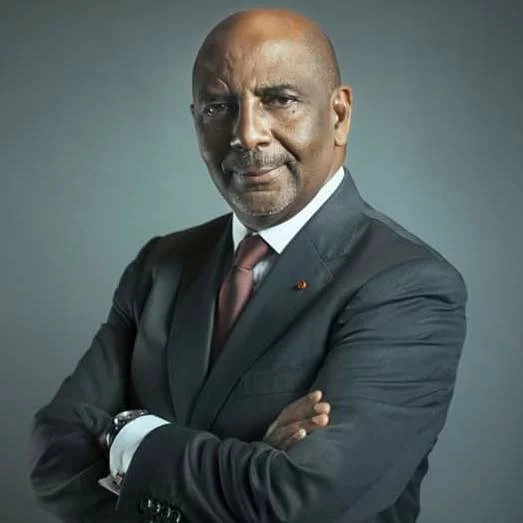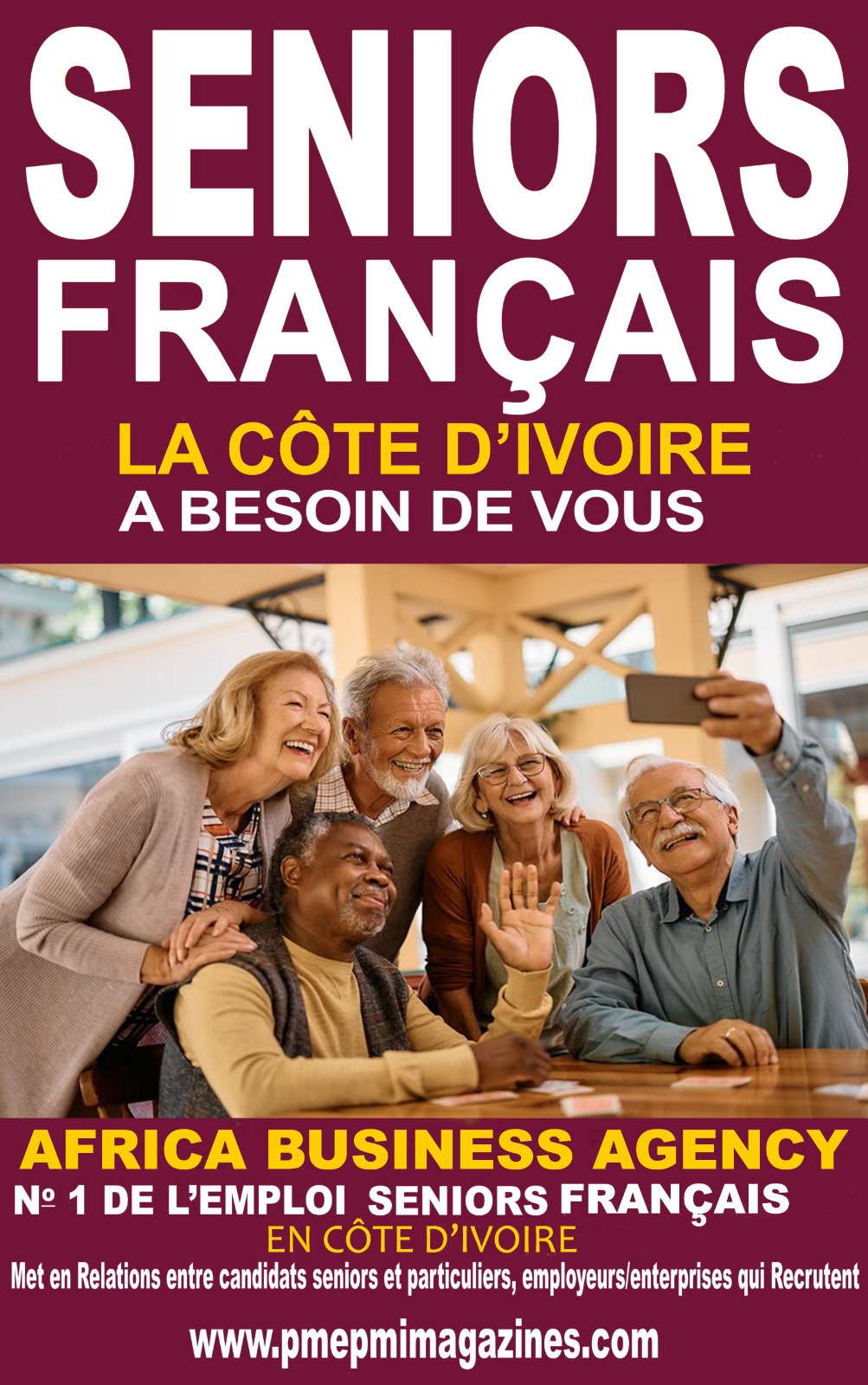Le Burkina Faso a décidé de ne plus utiliser le coton génétiquement modifié de Monsanto. Mais le niébé transgénique, largement consommé par la population, est déjà dans les éprouvettes. Blandine Sankara prône l’autonomie pour rompre avec ces cultures transgéniques.
Le Burkina Faso fait partie des pays les plus pauvres du monde tout en étant le premier producteur de coton de l’Afrique subsaharienne. Son or blanc, largement vendu à l’export, représente 4 % du PIB. Dans les années 2000, Monsanto a fait miroiter aux producteurs une récolte plus lucrative grâce à une déclinaison OGM, le coton Bt, sans insecticides supplémentaires, et avec un meilleur rendement. Commercialisé en 2009, le coton a été rentable les trois premières années, mais très vite, les cultivateurs ont dû ressortir les insecticides, la qualité du produit s’étiolait, la quantité n’était pas au rendez-vous.
« En octobre 2014, le peuple a expulsé Blaise Compaoré du pouvoir après 27 ans de règne, raconte Aline Zongo, de la Copagen (Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain) ; à ce moment, la parole s’est libérée sur tous les sujets. On a enfin pu parler du coton Bt. »
En 2015, producteurs et entreprises cotonnières ont décidé de rompre progressivement les contrats avec Monsanto pour l’achat de semences OGM, jugées trop chères, pas assez rentables.
Dans un rapport commun avec CCFD-Terre solidaire et publié lundi 1 mai, la Copagen dresse le bilan de ces années de coton transgénique sous la formule « un fiasco national », et liste les promesses non tenues par la multinationale. Le prix des semences est passé entre 2009 et 2016 de 2300 à 27000 francs CFA ( 3,51 à 41,16 euros) pour un hectare ; à cela s’ajoutent les coûts des insecticides à nouveau nécessaires à partir de la troisième récolte. En parallèle, la longueur de la fibre du coton s’est raccourcie, dévaluant sa qualité ; sa graine s’est rapetissée, allégeant son prix, la récolte étant payée au poids. « Ce n’est pas tout, les cultures voisines, plutôt vivrières ont aussi été endommagées, détaille Aline Zongo, car les insectes qui n’allaient plus dans les champs de coton se sont réfugiés dans les champs voisins. C’est comme ça que des cultures de sésame ont été totalement détruites. » Elle s’inquiète aussi quant à la santé humaine et animale, « mais nous n’avons pas d’élément à ce sujet, aucune étude n’a été faite ».
Avec reseauinternational