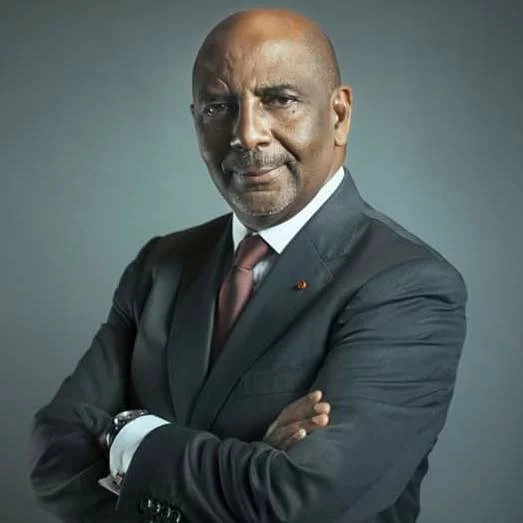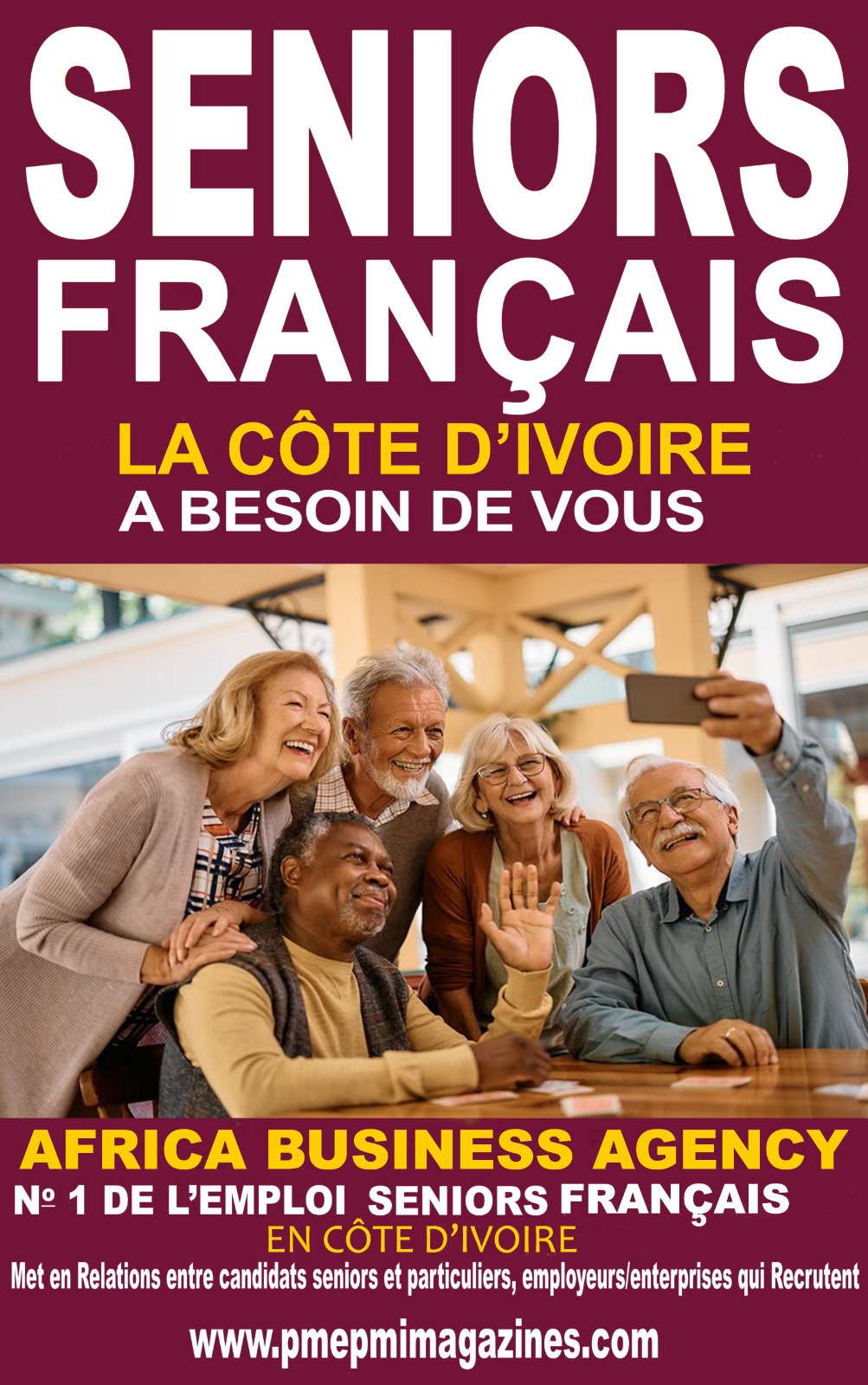De plus en plus de places financières africaines lancent des compartiments dédiés aux PME. Un mode de financement- et de placement- souvent avantageux. Mais derrière les effets d’annonce, la formule a encore du mal à s’imposer.
Pour les petites et moyennes entreprises africaines, le constat est amer : alors qu’elles représentent 90 % des sociétés privées du continent et contribuent pour plus de 45 % à l’emploi, rares sont celles à pouvoir décrocher un financement externe. Lucides, les équipes de la Banque africaine de développement rappellent ainsi « […] que plus de 70 % des PME accèdent difficilement au financement sur le moyen/long terme […]», les institutions financières traditionnelles étant souvent mal équipées pour évaluer et suivre les projets de ces entreprises.
Compartiments PME
D’autres options existent pourtant, à l’image des compartiments boursiers destinés aux PME, de plus en plus nombreux à voir le jour sur les places financières africaines. Aujourd’hui, une douzaine de bourses du continent disposent d’un compartiment spécifique, dédié uniquement aux petites et moyennes entreprises : le Growth Enterprise Market Segment de la bourse de Nairobi, le Small-and-Medium Enterprise Segment du Rwanda Stock Exchange, l’Alternative Securities Market de Lagos, le Ghana Alternative Exchange, sans parler des marchés plus matures tels que le segment alternatif de la BVMT de Tunis, le Nilex égyptien ou bien encore l’AltX de Johannesburg. Et la liste devrait encore s’allonger. A Abidjan, la BRVM a lancé fin mars le programme Elite1 , qui vise à accompagner dix entreprises à fort potentiel de la sous-région, vers la cotation sur le futur compartiment destiné aux PME de la place financière ivoirienne. En attendant une nouvelle cohorte d’entreprises bénéficiaires du programme, prévue d’ici la fin de l’année.
A l’origine de ces formules boursières dédiées aux PME, il y a d’abord une évidence : «si les places financières africaines attirent un nombre toujours croissant de grandes sociétés à la recherche de financements- et d’investisseurs en quête de placements-, elles semblent encore inaccessibles pour nombre de petites et moyennes entreprises, ces dernières étant souvent intimidées par le ticket d’entrée (processus d’introduction coûteux, démarches administratives complexes, réglementation contraignante) », rappelle Gérard Gasamagera, analyste chez le courtier MBEA Brokerage, à Kigali. Conscientes de ces difficultés, tout en étant désireuses d’élargir leur périmètre d’activité, de plus en plus de bourses du
continent ont décidé de lancer des compartiments spécifiquement conçus pour les besoins des PME, à l’image de ce qui se fait ailleurs dans le monde.
Dans cette configuration, les règles sont sensiblement assouplies (les PME accèdent ainsi à moindres frais à la Bourse afin de financer leur développement) mais sans que le régulateur ne transige sur les obligations légales de diffusion d’informations financières ni sur le respect des règles de bonne gouvernance. Autant de garanties offertes en somme aux actionnaires, qui peuvent de leur côté espérer des rendements accrus sur ces « valeurs de croissance ».
Réticence
Dans les faits, le système a néanmoins du mal à convaincre. Lancés au début des années 2010, l’Asem nigérian (8 entreprises cotées), le GAX d’Accra (4), l’EGM tanzanien (5) et le Gems de la Bourse de Nairobi (5) peinent ainsi à décoller, tandis que les marchés alternatifs des Bourses rwandaise et ougandaise attendent toujours l’arrivée de leurs premières entreprises à la cote. Idem à la BRVM d’Abidjan ou sur la place financière casablancaise où, malgré la volonté manifeste des autorités boursières de faire bouger les lignes, l’arrivée des PME à la cote se fait attendre depuis déjà plusieurs années. La Bourse reste pour beaucoup un univers ésotérique, et les entreprises comme les investisseurs peinent à se représenter les potentialités offertes. «Nous devons faire plus de pédagogie», concède volontiers Charles Nsamba, le responsable communication de l’Autorité ougandaise des marchés de capitaux. La barrière est aussi culturelle, selon le Directeur général de la Bourse de Kigali, Pierre Célestin Rwabukumba. «Beaucoup d’entrepreneurs préfèrent payer des taux usuraires à leur banque plutôt qu’ouvrir leur capital, communiquer et partager leurs profits», se désole le dirigeant du Rwanda Stock Exchange, dont le compartiment PME est toujours vide. Même réticence du côté des épargnants, estime Samuel Adejumo, de la firme d’investissement nigériane Pivot Capital pour qui «la performance des actions de PME cotées n’est pas suffisante pour attirer les investisseurs dans ce segment de marché, ces derniers achetant une action pour le gain en capital et en dividende». Autre limite de taille imputée aux compartiments PME, leur liquidité, «souvent très faible», explique Gérard Gasamagera.

Opportunités
Pourtant, certaines places comme Tunis, le Caire ou Johannesburg, où les marchés alternatifs comptent respectivement 13, 32 et 52 sociétés cotées, commencent à trouver leurs marques. Dernière en date à intégrer l’AltX de la bourse sud-africaine, la société financière Mettle Investments a rejoint un compartiment dynamique, dont la capitalisation boursière totale dépasse désormais le milliard de dollars. Une inclination pour le financement boursier qui ne se limite du reste pas qu’aux PME des pays de culture anglophone. Cité par notre confrère Jeune Afrique, en 2014, Kais Kriaa, président du directoire d’AlphaMena, un cabinet d’analyse financière basé à Tunis, rappelait ainsi que «les entreprises tunisiennes ont compris les avantages de l’ouverture de leur capital, ces dernières […] étant bien obligées de chercher des alternatives au crédit bancaire pour se financer». Une problématique familière à l’immense majorité des PME du continent, souvent confrontée à la réticence des banques, et qui représente donc une opportunité majeure pour les compartiments alternatifs destinés aux PME sur les bourses africaines, aux côtés d’autres canaux (mise en place de fonds de garantie, capital-investissement…). D’autant plus que «davantage d’incitations fiscales et de mesures d’accompagnement suffirait souvent à créer un écosystème plus favorable», suggère un bon connaisseur du dossier. Reste à voir si ce virage récent vers plus de compartiments PME- et plus d’inclusion financière- portera ses fruits dans la durée ou si au contraire, il se soldera par… un mirage.