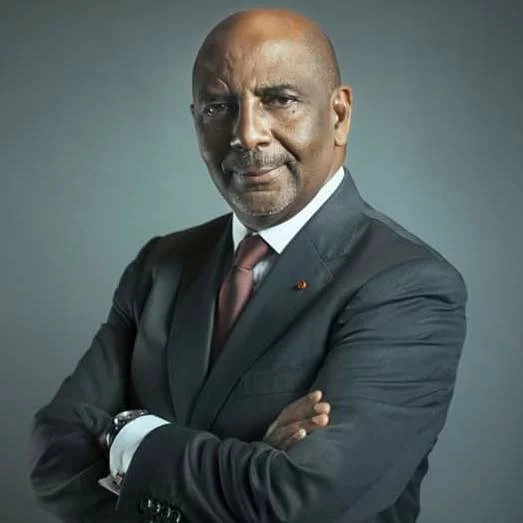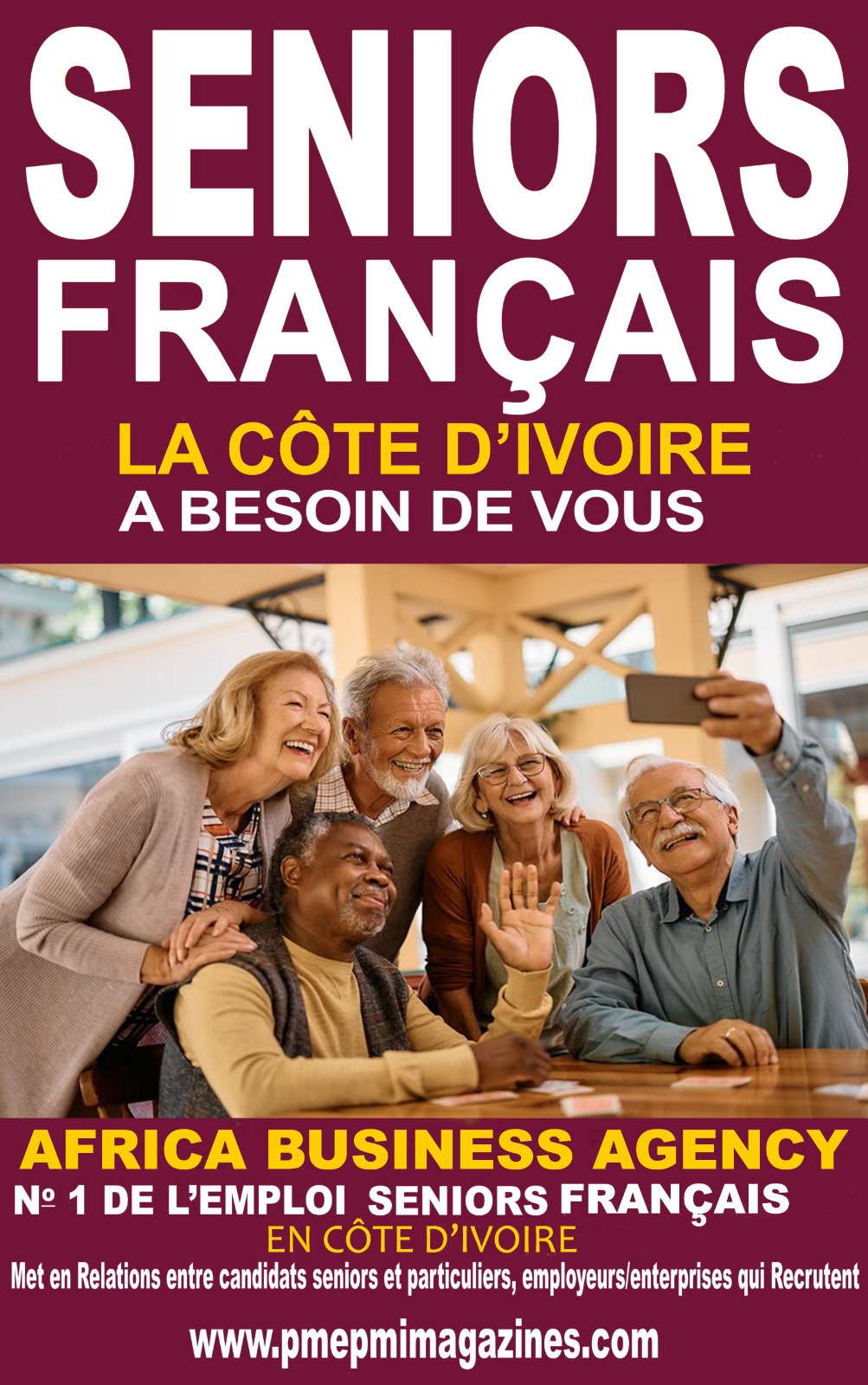Le « Statut de l’Entreprenant » est un nouveau régime juridique simplifié, gratuit, ouvert à toute personne physique qui exerce une activité civile, commerciale, artisanale ou agricole et qui souhaite se déclarer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). Il vise principalement à encourager l’enregistrement des opérateurs économiques du secteur informel pour faciliter leur insertion dans l’économie formelle et leur permettre d’accéder aux services bancaires et financiers.
Le statut de l’ « Entreprenant » est sans contexte une innovation majeure de la révision de l’Acte uniforme relatif au Droit commercial général de l’O.H.A.D.A. du 15 décembre 2010 intervenue à Lomé (TOGO).
Mais que signifie le mot « Entreprenant » en langage courant ?
Dans l’encyclopédie de la langue française, le mot « Entreprenant » a plusieurs synonymes. Il signifie entre autres : agissant, amorçant, attaquant, audacieux, aventureux, commençant, démarrant, entamant, galant, hardi, intentant, s’engageant, tentant. Tous ces termes désignent en quelque sorte celui qui vient de commencer une initiative ou une activité économique de quelque nature que ce soit : ouverture d’un fonds de commerce, d’un fonds civil ou d’un fonds artisanal.
L’Acte uniforme relatif au Droit commercial général de l’O.H.A.D.A. du 15 décembre 2010 en règlementant le statut de l’entreprenant (en quatre articles au total) ne s’écarte pas de cette signification littéraire de la notion. L’article 30 alinéa1 de ce texte dispose que : « l’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent Acte uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole ».
Au demeurant, il s’agit d’un nouveau statut professionnel qui est ainsi organisé, ou si on peut dire, d’un nouvel acteur institué dans les activités économiques des Etats membres de l’O.H.A.D.A. De cette manière, l’O.H.A.D.A. entend donner la priorité à l’esprit d’entreprise sur les obstacles formels, limiter les investissements du débutant et faciliter le retour dans le circuit économique officiel. En somme, l’entreprenant est celui-là qui était communément appelé « le commerçant informel ».
Les motivations profondes qui ont présidé à ce qui semble être l’innovation la plus retentissante de la reforme entreprise par le législateur OHADA en 2010 est ici clairement affichée : la lutte contre le secteur informel.
Appelé économie populaire ou économie informelle, le secteur informel est une caractéristique essentielle des économies de l’Afrique subsaharienne, et même qu’il est l’expression de la désorganisation dont celles-ci souffrent. Il en résulte que la démarche du législateur OHADA est une manière souple de faire entrer dans le circuit formel un certain nombre d’opérateurs économiques qui évoluent en marge du circuit formel traditionnel.
Plusieurs critères retenus dans la définition de l’entreprenant par l’AUDCG justifie nettement cette considération :
L’entreprenant est tout d’abord défini comme un entrepreneur individuel, personne physique. Ce qui exclut les personnes morales, celles-ci supposent un minimum d’organisation et une certaine publicité. La notion d’entreprenant concerne une personne qui est à ses débuts dans l’exercice d’une activité économique, ou alors quelqu’un qui a commencé l’activité économique, depuis un certain temps, mais qui n’a pas encore eu la chance de progresser. En somme, c’est un acteur économique dont l’activité n’est pas encore scientifiquement organisée et épanouie. Cette caractéristique correspond exactement à l’activité des petits détaillants ou prestataires qui pullulent dans les villes africaines, par exemple.
Ensuite, le statut de l’entreprenant est un statut optionnel qui fait appel au petit entreprenariat. En conséquence, c’est un statut qui n’est pas contraignant et qui ne s’applique pas de plein droit (il s’obtient à la suite d’une simple déclaration sans frais en principe).
En outre, l’entreprenant désigne concrètement soit un petit commerçant, soit un professionnel voisin du commerçant tel un artisan, un agriculteur ou encore un professionnel civil (article 30 précité) dont le chiffre d’affaires n’a pas atteint le seuil lui permettant de faire face aux obligations légales requises d’un professionnel. Ici, le domaine de la notion d’entreprenant – très large faut-il le souligner- rend compte de la gamme variée d’activités que représente le secteur informel dont il est difficile par ailleurs de définir tous les contours.
En décidant ainsi de règlementer un statut nouveau dédié à un acteur spécifique de la sphère commerciale, le Droit OHADA ouvre son champ d’application ratione-personnae à des professionnels qui ne sont pas traditionnellement régis par les règles commerciales, et se conforme aux économies africaines dont le désordre est illustré par l’informel.
Même s’il n’est pas typiquement africain, les caractéristiques et l’importance économique et sociale du secteur informel lui confèrent sur le continent un caractère singulier. L’informel est le « principal moteur de la construction des villes et de l’animation de la vie urbaine » en Afrique. La plupart des principales villes et spécifiquement celles des 17 Etats membres de l’O.H.A.D.A. (répartis entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale) sont quasiment « le fruit du travail de cette économie populaire ».
Le secteur informel innerve pratiquement les économies africaines : il « bâtit les maisons, fabrique les meubles, crée et transforme les produits agricoles, répare les automobiles, anime les marchés, organise l’épargne, distrait (restaurants, troupes théâtrales et musicales), habille (tailleur, coiffeur, blanchisseur) et même soigne (tradi-praticiens) ». Ces activités permettent la satisfaction des besoins fondamentaux des populations concernées, tels que se nourrir, se loger, se vêtir, se former, se soigner, se déplacer et peuvent être regroupées, selon l’OCDE en :
informel de production : qui regroupe les activités agricoles périurbaines, la menuiserie bois et métal, la construction de bâtiments et autres travaux publics (BTP) ;
informel d’art : on retrouve la bijouterie, la sculpture, le tissage, la couture, la broderie, la maroquinerie, la cordonnerie, la peinture ;
informel de services, qui renferme la restauration populaire, les transports urbains, la coiffure, la couture, la réparation mécanique ou électrique ;
informel d’échanges, spécialisé dans la distribution, les échanges, etc.
On remarque dès lors par son objet, que la notion d’entreprenant est un conglomérat d’opérateurs économiques informels : l’agriculteur et l’artisan se retrouve dans l’informel de production, puis dans l’informel d’art ; le (petit) commerçant (au sens strictement économique et non juridique) sera compris dans l’informel de services, et in extenso, dans l’informel d’échanges. Bien sûr, la distribution et les échanges représentent la majeure partie de l’économie informelle. Néanmoins à côté de l’artisanat traditionnel, se développe l’informel de production qui vend des produits comparables aux biens et services modernes mais pour des pouvoirs d’achats plus faibles et avec des moyens plus limités.
Sur le plan historique, l’expression secteur informel tire sa source du Bureau International du Travail (BIT) dans un rapport en 1993 qui le décrit comme : « un ensemble d’unités produisant des biens et des services en vue principalement de créer des emplois et des revenus pour les personnes concernées. Ces unités, ayant un faible niveau d’organisation, opèrent à petite échelle et de manière aspécifique, avec peu ou pas de division entre le travail et le capital en tant que facteur de production. Les relations de travail, lorsqu’elles existent, sont surtout fondées sur l’emploi occasionnel, les relations de parenté ou les relations personnelles et sociales plutôt que sur des accords contractuels comportant des garanties en bonne et due forme ». On retient de cette description que le secteur informel a une double caractéristique. D’un côté, des petits producteurs appartenant à des réseaux caractérisés par des relations interprofessionnelles de confiance et de coopération et liés aux unités de domestiques ne dissociant pas le budget domestique du budget productif, qui utilise la main-d’œuvre familiale et qui diluent le surplus au sein de la famille. De l’autre côté, ces mêmes petits producteurs sont insérés au marché et subissent la concurrence. Ce qui en fait même une économie parallèle. D’une manière générale, l’informel est l’expression de la capacité des économies à faible productivité (pour notre cas, les économies africaines) à résister aux chocs extérieurs et qui cherchent leur insertion à une économie internationale perçue comme mafieuse, celle d’un « monde sans loi » et qui est favorisée par la décomposition des Etats. Le secteur informel est comme on le voit, pour la plupart des populations africaines, un mode de vie, voire de survie. Présenté sous cet angle, on peut légitimement s’interroger sur ce que le Droit, et ici le Droit des affaires OHADA gagne à intervenir dans cette lutte -naturelle- pour la vie. L’analyse des fondements juridiques pourra certainement nous édifier sur cette question.
Depuis longtemps le secteur informel est un casse-tête pour le juriste. L’informel en effet, c’est le non Droit en concurrence avec le Droit. Comme présenté dans la description que le BIT en fait, le secteur informel se compose essentiellement d’activités pratiquées plus ou moins en marge des lois et des institutions officielles. C’est un désordre créé par des circonstances de fait qui finissent par avoir raison du Droit. L’importance du secteur informel est caractéristique d’une économie mal organisée ou sous-organisée. Dans les pays africains en général et les membres de l’O.H.A.D.A. où le phénomène est très récurrent, les causes de cette situation de fait sont multiformes :
La pauvreté, car la quasi-totalité des acteurs de l’informel commence leurs activités sans réel capital ;
L’exode rural qui concerne la grande partie de la population active qui par le phénomène du mirage des villes, viennent grossir la population urbaine, à la recherche du bien-être ;
Le chômage qui est le corollaire de l’exode rural. En gros, il s’agit généralement des « having not » qui sont en courses pour leur survie !
Evidemment, La situation du professionnel informel n’est pas forcément celle d’un naufragé qui cherche désespérément un secours que les pénalistes décrivent.
Le secteur informel est une véritable économie parallèle. Ce qui n’est pas sans conséquences négatives, à tous égards : D’abord pour le professionnel informel, il y a un problème de confiance et d’accès au crédit. D’un côté il est traqué par l’autorité et de l’autre, il n’a pas la confiance de la banque et de l’institution financière. Il se résout donc au quotidien en vivant au jour le jour comme une poule. Pour l’Etat, le secteur informel représente une perte énorme. Car en termes d’impôts et de contributions sociales, il est impossible d’imposer et de recouvrer les activités informelles.
Enfin, pour les professionnels des secteurs organisés la situation est encore plus délicate. Moins nombreux qu’ils sont à contribuer, ils subissent la pression fiscale, et sociale. Le plus difficile pour eux est qu’ils sont déloyalement concurrencés sur le marché. … Et donc, de tout temps, la question fondamentale a été toujours celle-ci : Quelle solution idéale contre le secteur informel ? C’est sûrement pour apporter une réponse à cette question de première importance pour le développement des Etats africains que le législateur O.H.A.D.A. a institué le statut de l’entreprenant en y regroupant les acteurs qui sont des secteurs de prédilection : agriculture, artisanat, commerce de distributions et d’échanges de biens et de services. La méthode choisie par le législateur africain de l’O.H.A.D.A. est celle de la séduction : puisque l’on ne peut pas combattre le secteur informel par la technique de la corde raide, il vaut mieux lui tendre la main ; il faut lui faire des offres, et en contrepartie, on lui demande tout simplement de s’identifier et de tenir un système minimal de trésorerie. Et dès qu’il finit de s’identifier, il n’est plus dans l’informel, il devient formel. C’est ce qui ressort des dispositions de l’article 30 alinéa 4 et 5 : « … Lorsque durant deux exercices consécutifs, le chiffre d’affaires de l’entreprenant excède les limites fixées pour son activité par l’Etat- partie sur le territoire duquel il les exerce, il est tenu dès le premier jour de l’année suivante et avant le premier trimestre de cette année de respecter les charges et obligations applicables à l’entrepreneur individuel. Dès lors, il perd sa qualité d’entreprenant et ne bénéficie plus de la législation spéciale applicable à l’entreprenant. Il doit en conséquence se conformer à la règlementation applicable à son activité. »
Aussi, les réalités économiques étant très différentes d’un pays à un autre, le législateur communautaire de l’O.H.A.D.A. s’est réservé de décrire l’appât qu’il faut jeter à l’eau pour avoir le poisson. Chaque Etat membre est mieux indiqué pour définir ce qu’il doit accorder comme concession pour attirer l’acteur informel. Pour autant, le législateur ne manque pas de tracer la voie. Quelque chose peut être fait en matière notamment d’imposition fiscale et d’assujettissement aux charges sociales (article 30 alinéa 7 in fine).
Les obligations comptables de l’entreprenant sont définies aux articles 31 et 32 de l’AUDCG. Elles consistent en l’obligation pour l’entreprenant d’établir, dans le cadre de son activité, au jour le jour, un livre mentionnant chronologiquement l’origine et le montant de ses ressources en distinguant les règlements en espèces et autres modes de règlement d’une part, la destination et le montant de ses emplois d’autre part. Ledit livre doit être conservé pendant cinq ans au moins (art. 31). Si l’entreprenant exerce des activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et de denrées ou de fourniture de logement, il doit tenir un registre, récapitulé par année, présentant le détail des achats et précisant leur mode de règlement et les références des pièces justificatives, lesquelles doivent être conservées (art. 32). La comptabilité décrite ainsi est comme on le voit une comptabilité du type recettes-dépenses, dégageant le résultat de l’exercice. Dès lors, de très petites entreprises dont les moyens matériels ne permettent guère la tenue d’une comptabilité fiable et qui naguère, étaient contraintes de demeurer dans l’informel trouve ici une chance d’améliorer leur gestion comptables.
En ce qui concerne le régime de prescription, la tendance du législateur O.H.A.D.A. est de faire de l’entreprenant un « petit commerçant ». Cette tendance se confirme par le régime de la prescription prévu par l’article 33 de l’AUDCG : « les obligations nées à l’occasion de leurs activités entre entreprenants ou entre entreprenants et non entreprenants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ». Ce qui rappelle la prescription de l’article 16 du même Acte uniforme applicable au commerçant. En d’autres termes, comme le commerçant, l’entreprenant et ses contractants doivent déjà commencer par respecter la diligence et la célérité qui caractérisent les affaires.
Voici donc ici, le substrat technique de l’O.H.A.D.A. qui a fait rêver le Mr Keba MBAYE de vénérée mémoire, remis dans toute sa dynamique. L’O.H.A.D.A. est vraiment un outil technique imaginé par les africains pour jouer « le premier rôle dans l’intégration économique et la croissance » en Afrique, et se faisant, au service des économies de ses Etats membres à travers un statut spécifique dédié à l’entreprenant. Voilà ce qui est de l’applicabilité du statut de l’entreprenant. Quid de son application ? Théoriquement, celle-ci est censée être effective dès lors que chaque Etat-partie aura fixé « les mesures incitatives notamment en matière d’imposition fiscale et d’assujettissement aux charges fiscales ». Vu que le phénomène de l’informel est à la fois profond et complexe, et au regard de la disparité entre les économies concernées, l’on a pensé que ces mesures seraient prises rapidement dans l’ensemble des Etats membres de l’OHADA.
Mais, quelques six ans après l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme révisé, beaucoup d’incertitudes subsistent quand à la mise en œuvre effective de la réforme. Il convient alors de se demander si l’OHADA parviendra à mettre de l’ordre dans ce qui paraît comme un « maquis économique » ? Il est claire que le statut de l’entreprenant telle qu’il apparaît dans l’AUDCG de décembre 2010 permet de constater que la démarche du législateur communautaire est de conquérir (avec des armes et des astuces juridiques) le secteur informel, du moins d’y mettre un peu d’ordre. Rien que la diversité des acteurs regroupés sous ce nouveau statut justifie cette logique. Une lueur d’espoir semble néanmoins poindre à l’horizon au regard de l’expérience présentement en cours au Bénin.
En effet, le Bénin est le premier pays de l’espace OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) à mettre en place de façon effective ce nouveau statut qui a été adopté par l’institution régionale en décembre 2010 et entré en vigueur en mai 2011. Le lancement officiel du « Statut de l’Entreprenant » a fait suite à une évaluation positive d’une phase pilote, menée d’avril 2014 à mars 2015 qui a porté sur un échantillon de 2 400 micro- entreprises informelles situées à Cotonou et sur un groupe de contrôle de 1 200 entreprises. Cette phase a conduit à la formalisation de 424 entreprises, dotées désormais d’un statut formel d’Entreprenant et bénéficiant de divers services d’accompagnement, notamment en matière de tenue de comptabilité, de formation, de préparation de plan d’affaires, d’accès à divers services bancaires et de protection contre les abus de l’administration, et d’une fiscalité plus simple et plus juste dénommée « Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) », à compter du 1er Janvier 2016. Le succès de la phase pilote a été déterminant pour la généralisation du « Statut de l’Entreprenant » à l’ensemble du territoire national.
Ce faisant, « Le Bénin vient de montrer aux 16 autres Etats membres de l’OHADA qu’à travers une politique bien adaptée, l’on peut intégrer de manière réussie les millions d’entreprises (TPE, PME) qui opèrent en marge de l’économie formelle afin qu’elles deviennent plus prospères et créatrices d’emplois. » Cela devrait inspirer les pays voisins comme le Burkina Faso qui peinent encore à mettre en œuvre ce statut alors qu’il gagnerait à mettre de l’ordre dans le secteur informel pour créer plus d’emplois et réduire la pauvreté.
En regroupant sous une règlementation unique et simplifiée les petits commerçants, les artisans, les agriculteurs, les détaillants et les prestataires de services divers qui évoluent essentiellement en marge du circuit officiel, l’O.H.A.D.A. s’attaque à un mal fondamental dont souffrent les économies africaines : le secteur informel, ou comme le disent bien les économistes, l’hypertrophie du secteur tertiaire. Ce qui en soit, constitue une avancée majeure, disons un pas de géant de la part du législateur africain, dans le processus d’amélioration du Droit des affaires et pour l’émergence de ces affaires, on peut être désormais rassuré de la volonté des dirigeants africains de faire de leur espace géographique, un espace juridique et économique sécurisé et propice.
Le « Statut de l’Entreprenant » est un nouveau régime juridique simplifié, gratuit, ouvert à toute personne physique qui exerce une activité civile, commerciale, artisanale ou agricole et qui souhaite se déclarer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). Il vise principalement à encourager l’enregistrement des opérateurs économiques du secteur informel pour faciliter leur insertion dans l’économie formelle et leur permettre d’accéder aux services bancaires et financiers.
Avec ecodufaso