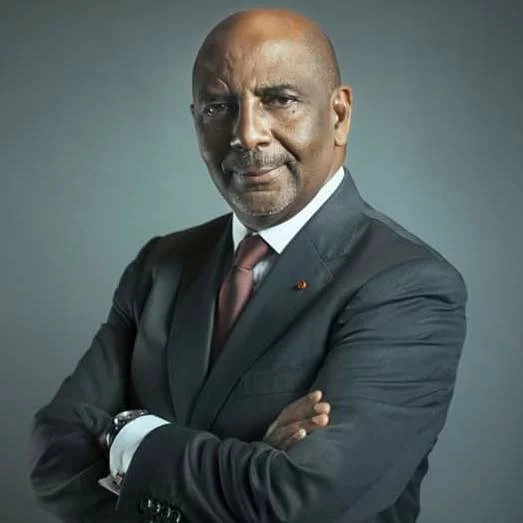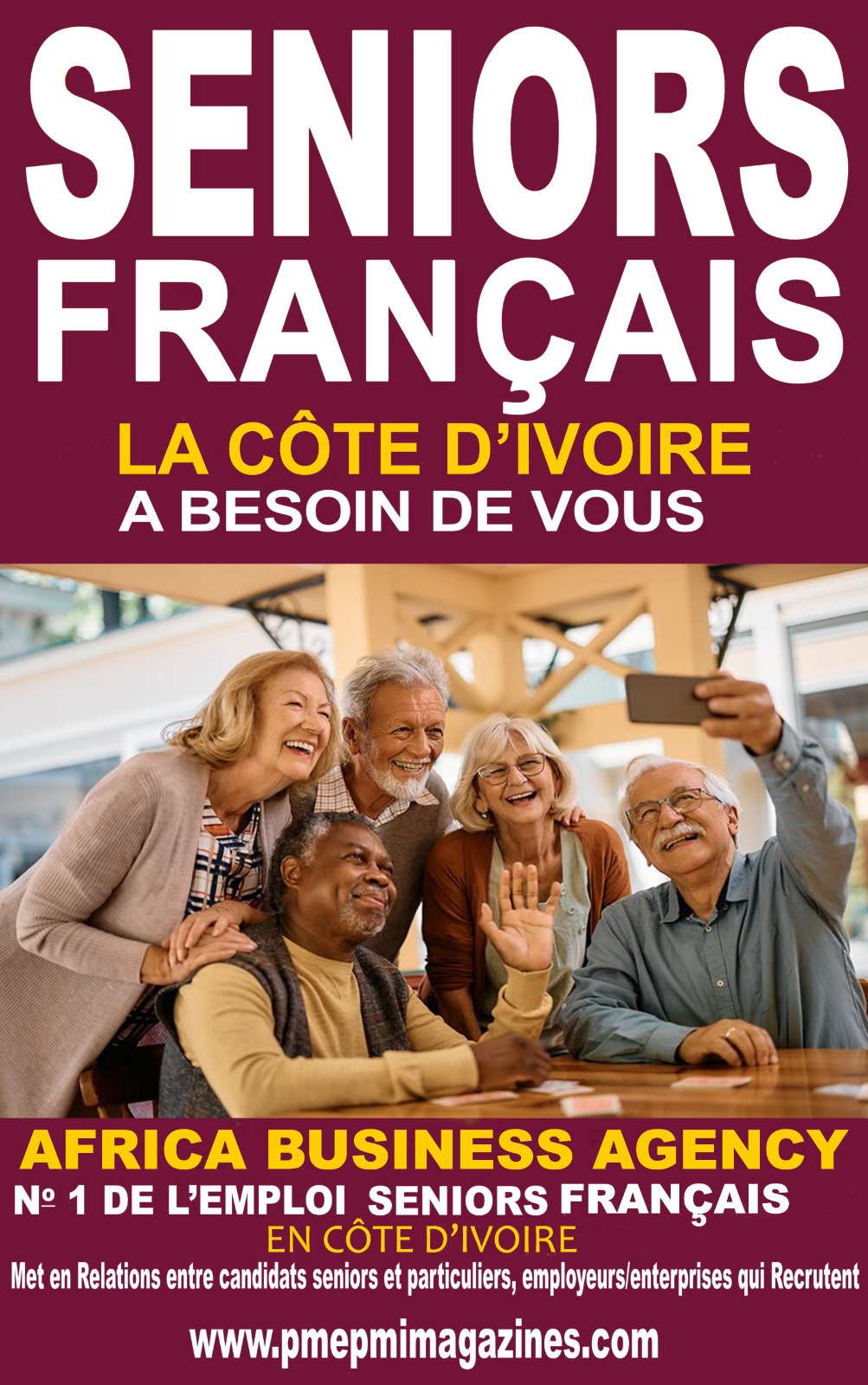Après l’Afrique du Sud et le Sénégal, la Côte d’Ivoire lance à son tour une émission de sukuks, les « obligations » islamiques.
Le Sénégal avait fait figure de pionnier en juin 2014 en levant 100 milliards de francs CFA (150 millions d’euros) par le biais de sukuks, des obligations compatibles avec la charia. L’Afrique du Sud lui a emboîté le pas, trois mois plus tard, émettant pour 500 millions de dollars de ces mêmes obligations. Et c’est désormais au tour de la Côte d’Ivoire de tester le marché des financements islamiques.
Le pays vient de lancer une émission de sukuk, pour 150 milliards de francs CFA, soit 230 millions d’euros. L’opération a commencé le 20 novembre, et les investisseurs peuvent souscrire jusqu’au 21 décembre. Les fonds obtenus seront affectés à des projets de développement. En cas de succès, le gouvernement ivoirien compte bien renouveler l’opération ultérieurement. Il pourrait également faire des émules chez ses homologues, notamment au Niger et au Nigeria.
Pour ces pays, l’intérêt de ce type d’emprunt est d’abord de diversifier leurs sources de financement. Alors que les investisseurs internationaux traditionnels se montrent plus réticents (lire ci-dessus), ils peuvent accéder à une base d’investisseurs nouvelle, les prêteurs soumis à la charia. D’autant que ces derniers disposent de plusieurs milliards de dollars de liquidités, qu’ils peinent à investir.
Le marché s’organise
En effet, l’un des principaux émetteurs de sukuk, la Banque centrale de Malaisie, qui représentait plus d’un tiers du marché primaire, selon Standard & Poors, a cessé ses émissions. Du coup, les nouveaux sukuks ne représenteront que 50 à 60 milliards de dollars, contre une prévision initiale comprise entre 100 et 115 milliards. Les investisseurs se trouvent donc en manque de papier nouveau. Ce déséquilibre profite aux emprunteurs. La Côte d’Ivoire a négocié un rendement de 5,75 % sur cinq ans avec les investisseurs islamiques, contre 6,625 % pour son émission d’eurobonds à 11 ans en avril dernier.
Pour mieux accueillir ces émetteurs, le marché est en outre en train de s’organiser. De plus en plus d’opérations nouvelles réutilisent la documentation juridique d’opérations antérieures. Le début d’une standardisation essentielle à toute montée en puissance.
source://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021518840412-pourquoi-la-finance-islamique-seduit-de-plus-en-plus-les-pays-africains-1179767.php?0O3TIpwKSkjVwuOu.99#xtor=CS1-25